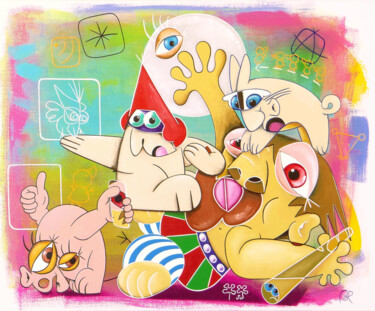LA CONNAISSANCE EST L'ARME ULTIME (2022)Peinture d'Esteban Vera (EVera).
LA CONNAISSANCE EST L'ARME ULTIME (2022)Peinture d'Esteban Vera (EVera).
 "SANS VISAGE" (2022)Sculpture de Mammad Rashidov.
"SANS VISAGE" (2022)Sculpture de Mammad Rashidov.
Facebook, Instagram et Twitter en peinture !
J'ai voulu mener une enquête afin de comprendre si l'iconographie des médias sociaux avait réussi à entrer dans le langage artistique, en suivant en partie la leçon désormais bien connue du Pop art dans les années 1950, qui a fait ses débuts et s'est déplacé, introduisant dans le monde créatif des images tirées des médias et de la culture populaire, représentant un changement qui continue à se réinventer jusqu'à aujourd'hui, rendant manifestes les dernières tendances en matière de communication, miroir inexorable de la société de consommation de masse. Par conséquent, cherchant principalement la "réutilisation", la réinterprétation, l'enrichissement et l'actualisation de tout ou partie des principes Pop susmentionnés par les visions et les langages de l'art contemporain, j'ai parcouru la base de données Artmajeur, où, grâce à l'utilisation de mots-clés précis tels que Facebook, Instagram et Twitter, j'ai effectivement réussi à entrer en contact avec des peintures, des sculptures et des dessins inspirés par ces médias sociaux actuels. Principalement, les œuvres résultant de mon enquête contenaient les logos en question, des symboles populaires destinés à devenir des véhicules de nouveaux messages pour l'art, associés sans équivoque à l'histoire des médias sociaux susmentionnés, ainsi qu'à l'évolution des caractéristiques de leur marque très populaire. Par conséquent, afin de vous montrer ce que je viens de dire, je vais commencer dans l'ordre des médias sociaux énumérés ci-dessus, en commençant par la première œuvre qui fait l'objet de mon analyse : Faceless de Mammad Rashidov, une tête sculpturale dans laquelle la représentation du visage humain est partiellement dissimulée par le logo Facebook, qui, gravé dans la "chair", lui est superposé, le dissimulant presque, ce qui me fait penser à la façon dont, désormais, nos identités réelles s'avèrent plutôt compromises, puisqu'elles sont associées de manière indélébile aux identités en ligne, qui, lorsqu'elles n'existent pas, privent effectivement les sujets d'une partie très vivante, ainsi que d'un mode, de l'interaction humaine. L'homme, qui n'existe presque plus s'il ne se connecte pas en ligne et ne commente pas les images avec des cœurs, des likes et des smileys, semble avoir incorporé le logo du fils le plus célèbre de Mark Zuckerberg dans sa propre identité, l'augmentant, présentant maintenant sur son visage les signes de sa double identité, ou plutôt de sa double vie, marquée par les moments où il respire réellement et ceux où c'est seulement son image photographique qui le fait pour lui. Le logo qui apparaît dans l'œuvre de l'artiste d'Artmajeur ajoute en revanche un sens supplémentaire à la sculpture, puisqu'il nous raconte comment le symbole de Facebook s'est imposé dans l'explication du nom de l'entreprise, qui, écrit en lettres minuscules sur un rectangle bleu, semblait donner voix à un choix chromatique peut-être dicté par le deutéranopia-daltonisme rouge-vert de Zuckerberg. Malgré certains changements de ce dernier, c'est bien l'icône du média social, sujet même de Mammad Rashidov, devenue de plus en plus minimaliste au fil des années, qui nous intéresse.
 LA COMÈTE INSTAGRAM (2023)Peinture de Mario Venza.
LA COMÈTE INSTAGRAM (2023)Peinture de Mario Venza.
 TWITTER 2.0 - SHITTER (2022)Peinture de Deb Breton.
TWITTER 2.0 - SHITTER (2022)Peinture de Deb Breton.
En ce qui concerne le logo d'Instagram, cependant, ce dernier a changé au fil des années tout en présentant une constante : l'allusion à la forme d'un appareil photo instantané, visant à refléter la désignation clé du réseau, comme le partage de photographies. Cependant, le symbole qui apparaît dans l'œuvre d'Artmajeur qui nous intéresse, à savoir La comète Instagram de Mario Venza, est le symbole actuel qui, conçu en 2022, a mis à jour le logo de 2016, en affinant sa palette de couleurs mais en conservant son concept et ses formes. Quant à l'œuvre de l'artiste d'Artmajeur, elle semble faire allusion au triomphe d'Instagram sur les autres médias sociaux, puisque son logo est placé devant, et dans un format plus grand, d'autres icônes bien connues, faisant peut-être allusion au fait que les jeunes, entre 18 et 29 ans, sont généralement plus attirés par les médias sociaux en question. Cette hypothèse pourrait être en ce sens confirmée par le jeune âge du sujet féminin représenté dans la toile, prêt à poser sur Instagram certainement sans tenir compte de la façon dont, la censure, pourrait effectivement agir sur sa nudité plutôt explicite. En outre, en parlant de Twitter, il convient de noter l'œuvre éponyme de Deb Breton, conçue pour salir le média social récemment acquis par Elon Musk, un personnage qui apparaît à l'arrière-plan en train de rire, sûrement inconscient de la réinterprétation satirique de l'ancien logo du média social en question. L'intention profanatrice de la peinture de l'artiste Artmajeur est rendue explicite, non seulement par l'iconographie évidente, mais aussi par la description de l'œuvre faite par Breton lui-même, prêt à révéler comment le nouveau Twitter 2.0. est en réalité un média destiné à favoriser la propagation de la haine et de la conspiration au nom de la liberté d'expression. En effet, les médias sociaux sont avant tout constitués de personnes et, plutôt que de blâmer Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc., nous devrions plutôt nous interroger sur la qualité du contenu que nous partageons personnellement. Certes, les médias sociaux n'ont pas été conçus pour faire circuler une information de qualité, prête à promouvoir l'amélioration du développement des consciences, mais chacun d'entre nous, libre d'agir, pourrait réellement faire un effort pour diffuser et créer quelque chose de significatif. À ce stade, cependant, il convient de noter que le célèbre petit oiseau de Twitter a été remplacé par un symbole X moins populaire qui, voulu par le nouvel acquéreur Musk, semble en fait manquer l'allusion iconique au gazouillis des messages des médias sociaux. Enfin, la narration passe de Facebook, Instagram et Twitter aux applications WhatsApp, GoogleMaps et Tinder, qui seront racontées par d'autres œuvres issues de la riche base de données d'Artmajeur !
 RESTER CONNECTÉ MÊME AU MILIEU DU COVID 19 (2020)Peinture de Samuel Itoya Odiboh.
RESTER CONNECTÉ MÊME AU MILIEU DU COVID 19 (2020)Peinture de Samuel Itoya Odiboh.
Samuel Itoya Odiboh : Rester connecté même en plein Covid-19
Comme le montre l'œuvre d'Artmajeur Odiboh, conçue à l'époque de la pandémie de Covid-19, les êtres humains, malgré les distances sociales imposées par l'urgence sanitaire, ont toujours pu communiquer grâce à une multitude de médias sociaux et d'applications, parmi lesquelles se distingue, tant par son ancienneté que par sa popularité immortelle, Whatsupp ! Le logo vert de cette plateforme de messagerie gratuite, mentionné par le tableau en question, a pour but de révéler la fonction de l'application, car il est composé d'éléments de design relativement simplistes, à savoir une bande dessinée textuelle, censée symboliser un message envoyé ou reçu, à l'intérieur de laquelle un téléphone a été placé, faisant allusion à la capacité secondaire de WhatsApp, à savoir les appels et les vidéos. La seule chose qui reste obscure et quelque peu contradictoire est le fait que le téléphone figurant dans le logo est en réalité un modèle fixe et donc incapable, contrairement à un téléphone mobile, de réaliser pleinement ce qui est annoncé. Malgré cette incohérence, le message que l'artiste d'Artmajeur prend soin d'expliciter, en représentant une femme portant un masque chirurgical avec un Smathphone à la main, semble résolument clair, ainsi qu'étonnamment porteur d'espoir, puisque la pandémie de Covid-19 a effectivement démontré que la technologie représente un outil sur lequel on peut s'appuyer pour surmonter les difficultés, à tel point que dans Rester connecté même en plein Covid-19, les logos susmentionnés peuvent être interprétés comme des super-héros, qui interviennent de manière salvatrice dans la voiture du protagoniste, décidément éprouvé par la peur de la maladie et de la solitude.
 ICÔNE DE TINDER - HUILE SUR TOILE (2020)Peinture de Larisa Lavrova.
ICÔNE DE TINDER - HUILE SUR TOILE (2020)Peinture de Larisa Lavrova.
Larisa Lavrova : l'icône de Tinder
Voici les mots avec lesquels Lavrova présente son huile sensuelle : "L'icône Tinder : c'est le nom de l'œuvre d'art. Elle n'est pas réelle, elle est dans votre esprit et dans votre téléphone. Et peut-être que vous la verrez dans la réalité, peut-être pas. Mais pour l'instant, vous ne pouvez voir que les mots qu'elle a prononcés lors de la conversation téléphonique et ses photos. Donc, ce n'est que ton imagination....." Pour ceux qui l'ignorent encore, Tinder, auquel le titre et la chemise de l'effigie font explicitement référence, est l'une des applications mobiles de rencontre les plus populaires, dans laquelle les utilisateurs peuvent faire défiler les photos d'autres utilisateurs, aimer les personnes qui leur plaisent, peut-être leur parler et ensuite les rencontrer en personne. Cela n'est possible que si l'objet de notre intérêt, après avoir réciproquement aimé, décide de répondre à nos messages, rendant ainsi plausible son existence dans le monde réel. Une fois que la conversation tant attendue a été entamée, on peut, relativement étape par étape et en fonction des intentions des deux parties, procéder à une rencontre réelle, seul moyen par lequel il sera possible de comprendre si l'illusion alimentée par les photos et le chat de l'application, se révélera être une autre grosse bourde ou l'affaire du siècle. En ce qui concerne l'icône de Tinder, il convient de préciser en quoi le sujet de l'œuvre est en contradiction avec les politiques de l'application en question, qui n'accepte en effet pas les photos de nu, peut-être parce qu'une femme comme celle représentée par l'artiste d'Artmajeur pourrait effectivement faire partir en vrille tout le système, qui serait surchargé d'hommes et de femmes intéressés à voir en direct ce que l'image se prête, illusoirement ou non, à montrer. Enfin, en ce qui concerne le logo de Tinder, Lavrova a réinterprété celui qui est utilisé à ce jour depuis 2017, à savoir une icône minimaliste dans laquelle le symbole de la flamme a acquis une texture ombrée plus arrondie, allant de l'orange au rose.
 PANOPTIKON. (2022)Peinture de Ziemowit Fincek.
PANOPTIKON. (2022)Peinture de Ziemowit Fincek.
Ziemowit Fincek : Panoptique
Il y a d'abord eu les étoiles, puis les cartes, et maintenant le règne de Google Maps, un service Internet géographique développé par Google, qui permet de rechercher et d'afficher des cartes d'une grande partie de la terre, est devenu si populaire qu'il devrait également être étendu à l'usage privé, de sorte que, dans l'avenir, nous puissions même nous rappeler où se trouve la salle de bain de notre maison, puisque, maintenant, tout le monde semble snober les fans de boussole qui ont survécu. J'ai donc envie de demander : où êtes-vous maintenant ? En êtes-vous sûr ? Avez-vous demandé à Google Maps ? Ici, il faut espérer ne pas être dans le lieu explicité par le tableau de Ziemowit Fincek, ou Panopticon, qui, si l'on se réfère à la description de l'œuvre par le peintre, est la prison idéale conçue en 1791 par le philosophe et juriste Jeremy Bentham, dont la structure permettait aux gardiens de prison d'observer les prisonniers sans savoir s'ils étaient surveillés et quand ils l'étaient. De même, la terreur de l'outil "partager votre position", qui, s'il est effectivement laissé ouvert à notre insu, permettrait à Google Maps d'indiquer à notre mari la résidence de notre amant ou à notre mère nos habitudes les plus étranges, est ravivée en moi. À ce stade, il serait peut-être moins risqué, comme l'a fait le protagoniste de Panoptikon, de se couper la main pour taper à l'endroit qui nous intéresse, sans laisser de trace physique de notre mouvement...


 Olimpia Gaia Martinelli
Olimpia Gaia Martinelli