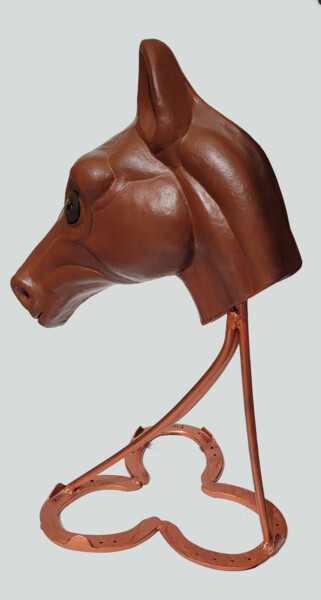Picrate, Le grand soir, 2022. Acrylique / pigments sur toile.
Picrate, Le grand soir, 2022. Acrylique / pigments sur toile.
Georges Braques et le brun
Au début, on dirait qu'il n'a rien à dire, mais le brun finit toujours par faire l'amour avec les châtaignes et l'automne".
Les mots de Fabrizio Caramagna, le "chercheur de merveilles" italien né en 1969 et spécialisé dans la création d'aphorismes à succès, résument avec force l'incapacité des premières impressions à saisir tout le potentiel des choses et des personnes, ainsi que le lien étroit entre la couleur brune et la réalité de l'automne, illustrée précisément par le noircissement des feuilles qui tombent. C'est précisément cette dernière association qui fait que cette nuance apparaît souvent limitée à un contexte spécifique, ainsi que monotone et peu attrayante, par rapport aux autres couleurs du cercle chromatique. En réalité, le brun a prouvé sa pertinence au fil des siècles dans le domaine de l'art, où il a été principalement utilisé pour créer des tons crépusculaires ou sombres, ainsi que pour la création de subtils dégradés de clair-obscur grâce aux teintes de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre brûlée. Dans d'autres contextes, cette combinaison de rouge et de vert est devenue le protagoniste de certains chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, au sein desquels elle a modelé les principaux sujets de la toile, comme, par exemple, l'Homme à la guitare (1912) de George Braque. La surface picturale de ce dernier tableau, littéralement disséquée en fragments de clair-obscur, abrite en son centre la clé qui tient la corde de la guitare, tandis que la présence de la figure masculine, difficile à identifier, ne peut être imaginée qu'en se référant au titre de l'œuvre. En effet, L'Homme à la guitare exige un effort considérable d'interprétation, car le spectateur doit abandonner la recherche de références au monde connu, pour se laisser conduire par les mécanismes de la raison, visant à reconstruire une dimension contemplative nouvelle et inédite. En ce qui concerne l'utilisation de la couleur, en revanche, l'œuvre repropose un chromatisme cher au cubiste français qui, à partir de 1907, c'est-à-dire pendant la phase du cubisme primitif, soumet les images à un processus de simplification drastique, visant à réduire la palette à des nuances de vert et de brun, processus bien exprimé par le chef-d'œuvre Case a L'Estaque (1908). Par la suite, et plus précisément pendant la période du cubisme analytique (1909-1922), le maître français s'est consacré à la réalisation de diverses natures mortes, dans lesquelles les objets, qui apparaissent comme réassemblés après avoir été démembrés, sont réalisés avec une prévalence égale de tons bruns, verts et gris, comme, par exemple, ceux du tableau : Violon et palette (1909), Piano et mandole (1909-10) et La clarinette (1912). Ce type de recherche artistique s'inscrit dans le prolongement des œuvres du cubisme synthétique, enrichi par la présence de chiffres et de lettres disposés autour des figures afin de " nourrir " le récit esthétique d'éléments figuratifs reconnaissables, dans le but évident de se distancer du mouvement de l'abstraction. Enfin, il convient de souligner comment cette récurrence du brun se retrouve également dans l'œuvre cubiste de Picasso, à tel point qu'il est possible de comparer deux tableaux similaires des maîtres précités, tels que Ma Jolie (1911-12) et Le Portugais (1911-12). C'est précisément dans ce contexte qu'il apparaît, une fois de plus, que la prédominance du brun et du gris a été utilisée dans le but de décomposer et de fragmenter la réalité qui nous entoure, à travers un savant clair-obscur, visant à générer des images trop complexes pour être interprétées par le seul usage de la vue.
 Ilya Volykhine, Kaituhi - bloc de l'écrivain lll, 2022. Huile sur toile, 140 x 120 cm.
Ilya Volykhine, Kaituhi - bloc de l'écrivain lll, 2022. Huile sur toile, 140 x 120 cm.
 Luis Guinea (Luison), Portrait de l'ADN. Ana Zubizarreta, 2002. Huile sur toile.
Luis Guinea (Luison), Portrait de l'ADN. Ana Zubizarreta, 2002. Huile sur toile.
Le brun dans l'art : de la préhistoire à nos jours
En effet, la terre d'ombre, un pigment argileux naturel composé d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse, avec lequel on obtient la couleur susmentionnée, était utilisée aussi bien à l'époque préhistorique, c'est-à-dire dans des peintures remontant à 40 000 ans avant J.-C., que dans l'art du Paléolithique supérieur, comme en témoignent les parois de la grotte de Lascaux, datant de 17 300 ans. La popularité de la couleur d'automne a été suivie dans l'Égypte ancienne, où les figures féminines des peintures funéraires étaient souvent exécutées avec un teint créé par l'utilisation de la terre d'ombre. Ce teint "bronzé" avait également du succès dans les mondes grec et romain, où l'on produisait une subtile teinte rouge-brun qui, réalisée avec l'encre d'une variété de seiche, fut ensuite utilisée par les plus grands maîtres de la Renaissance. À l'époque médiévale, en revanche, le brun, associé aux humbles robes des moines franciscains, était rarement utilisé dans l'art, car on lui préférait des couleurs plus vives et plus royales comme le rouge, le bleu et le vert. Le grand retour de la couleur des marrons s'est produit autour du XVIIe siècle, lorsque des artistes de la trempe de Rembrandt ont utilisé cette teinte pour créer des effets de clair-obscur, mais aussi pour créer un arrière-plan dans lequel les personnages émergent avec une grande proéminence. Enfin, en ce qui concerne les 19e et 20e siècles, les approches de cette couleur ont été différentes au cours de cette période, à tel point que le brun, détesté par les impressionnistes, était au contraire très aimé par Gauguin, un peintre qui a créé des portraits bruns lumineux des habitants et des paysages de Polynésie. Enfin, l'histoire du brun se poursuit à l'époque contemporaine, grâce aux points de vue originaux et inédits d'artistes d'Artmajeur tels qu'Oleksandr Balbyshev, Radek Smach et Marc Mugnier.
 Oleksandr Balbyshev, La fusion de Lenin, 2016, Huile sur toile, 90 x 70 cm.
Oleksandr Balbyshev, La fusion de Lenin, 2016, Huile sur toile, 90 x 70 cm.
Oleksandr Balbyshev: La fusion de Lenin
Dans le tableau du peintre ukrainien Balbyshev, le visage de Lénine apparaît fragmenté, comme s'il avait d'abord été peint puis, à un stade ultérieur, effacé de la surface de la toile brune, suivant des impulsions et des raisons qui, à première vue, semblent obscures. En réalité, comme l'explicite la description de La fusion de Lénine par l'artiste lui-même, cette façon de représenter l'homme politique fait allusion à l'impact que l'idéologie marxiste et léniniste a eu sur le monde de l'art russe, le transformant en un simple moyen de propagande politique, dépourvu de libre évolution. En outre, Balbyshev, en immortalisant Lénine, se demande également à quoi aurait pu ressembler l'enquête figurative de ce pays s'il n'y avait pas eu cette période d'oppression, une question à laquelle, hélas, il est impossible de répondre. En ce qui concerne l'histoire de l'art, il est toutefois bien connu que Rembrandt utilisait également le brun comme couleur de fond pour ses tableaux. En effet, quelques couches de craie de Bologne et de colle animale lissée étaient recouvertes d'une couche de plomb blanc dans de l'huile de lin mélangée à du noir, de la terra d'ombra ou de la terre de sienne brûlée.
 Radek Smach, Peinture abstraite brune va766, 2019. Acrylique sur toile, 100 x 80 cm.
Radek Smach, Peinture abstraite brune va766, 2019. Acrylique sur toile, 100 x 80 cm.
Radek Smach: Peinture abstraite brune
La Peinture abstraite brune rappelle un schéma de couleurs emblématique de l'histoire de l'art, car l'œuvre a été créée avec des nuances similaires à celles d'Autumn Rhythm (Numéro 30), une peinture de Jackson Pollock datant de 1950. Dans cette "version moderne" du chef-d'œuvre du milieu du XXe siècle, le principe de la technique du dripping est supprimé, car les couleurs sont régulièrement et soigneusement étalées sur le support de peinture, plutôt que d'être superposées "au hasard" par des coulures "désordonnées". Malgré ces différences, l'imposition de tons bruns rappelle, dans les deux œuvres, les atmosphères d'automne qui, dans le cas de Pollock, sont explicitement mentionnées dans le titre même de l'œuvre. En particulier, Rythme d'automne évoque cette saison par le mouvement énergique déclenché par la combinaison de lignes et de gouttes de couleur, presque comme pour revendiquer la vitalité d'une période de l'année souvent associée uniquement à l'hibernation ou au doux sommeil. Dans l'œuvre d'Artmajer, en revanche, la composition étudiée fait penser à un automne plus traditionnel, c'est-à-dire terreux, accueillant et routinier, marqué par une atmosphère qui pousse à l'introspection, au recueillement, à l'auto-soin et à la protection, visant à transformer l'individu et à le faire "fleurir" seulement au printemps prochain.
 Marc Mugnier, Sphéroïde en bois, 2020. Sculpture en bois, 40 x 40 x 40 cm.
Marc Mugnier, Sphéroïde en bois, 2020. Sculpture en bois, 40 x 40 x 40 cm.
Marc Mugnier : Sphéroïde en bois
La sculpture sphérique de Mugnier a été créée en assemblant des morceaux de chêne ciré, dans le but de révéler certains des mystères de la nature qui nous entoure. En effet, c'est précisément à travers l'utilisation de substances organiques que l'artiste, qui crée un lien avec la matière la plus authentique, veut transmettre la mémoire de notre planète, en l'accompagnant d'un message fort de paix et de respect pour le monde dans lequel nous vivons. Quant au rapport que le spectateur doit avoir avec Sphéroïde en bois, Mugnier tient à préciser qu'en dehors du message de soutien à la nature, il n'y a dans son œuvre aucune autre intention que de stimuler la libre interprétation de l'observateur. Enfin, du point de vue de l'histoire de l'art, le travail de l'artiste d'Artmajeur n'est pas sans rappeler les sculptures de Ben Butler, construites par l'assemblage de centaines de morceaux de bois qui, disposés en d'étranges formations, ne suivent pas de plan précis si ce n'est pour imiter des formations naturelles.


 Olimpia Gaia Martinelli
Olimpia Gaia Martinelli